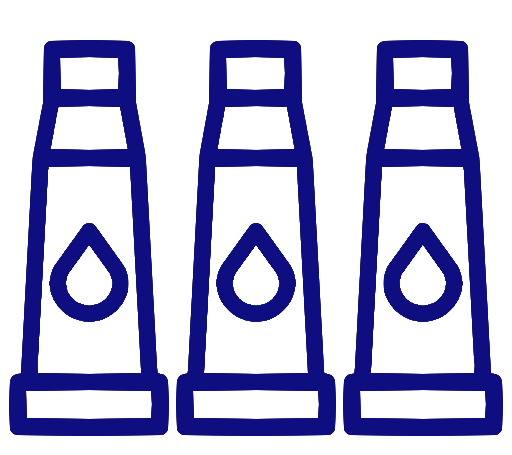Peindre des fleurs…
Peindre des fleurs…

Peindre une rose, voilà qui peut paraître anodin. Et pourtant, à celui qui prend la chose au sérieux, la fleur ouvre des espaces plus vastes que les océans. Rien n’est moins banal que de peindre une fleur parce que rien n’est, peut-être, plus essentiel que d’approcher le mystère de la gratuité. L’entreprise se dévoile comme un chemin qui réclame qu’on lui donne tout. Le prix de la gratuité c’est de n’avoir pas de prix…
J’ai récemment entendu, de la part d’un excellent peintre, qu’il est aujourd’hui devenu impossible de peindre des fleurs. Le sujet est galvaudé, les belles ont été, sous tous les angles et dans tous les styles, trop peintes. Elles sont, en quelque sorte, usées !
Pour les peindre, il me semble que des fleurs, et la rose est une reine, il importe avant tout de ne rien vouloir dire. Ici plus qu’ailleurs, le sujet réclame de ne rien rajouter. Chercherai-je à faire passer un message, à dire une once de moi au travers elle que sa splendeur aussitôt s’éteindrait. Dans le mystère qu’est son apparence elle seule s’exprime. S’il est impossible de peindre aujourd’hui une fleur, la première raison serait que l’on essaie de représenter l’idée que l’on a d’elle. Impossible ici de partir d’un concept. Elle ne peut tolérer que l’on parle à sa place. Vouloir ne rien en dire est déjà trop volontaire. Elle réclame l’expérience, une sorte de face à face désarmé. De ceux que je connais qui pratiquent l’exercice, à mon sens, seuls réussissent (et parfois avec excellence) ceux qui lui vouent une réelle admiration. L’équation se résoudra à ceci : plus tu l’aimes, mieux tu la peints… C’est aussi la deuxième raison pour laquelle il est impossible de peindre une fleur… Une part d’elle échappe toujours à la faiblesse de notre amour.
J’ai décidé de peindre une série de roses. Voilà des jours et des jours que je m’affronte à la tâche. Peindre des roses… Là plus qu’ailleurs, la conscience de la défaite est vive. La technique ne suffit pas qui toujours ramène en partie, à elle et pour elle, le sujet. Le désir, bien que nécessaire, échoue aussi tant qu’il garde cette part de violence qui cherche à s’emparer de l’objet. Peindre des roses, chaque jour je remets l’ouvrage avec ardeur et espérance et chaque soir, envahi du sentiment de n’avoir pas atteint le but, je quitte l’atelier, triste et désemparé.
Elles me réveillent et, tout aussi inquiet qu’impatient, je cherche dans la nuit un chemin vers elles. Ce que la rose demande au peintre qui voudrait la dire, c’est la virginité. J’entends par virginité cette liberté de garder, sur un trésor posé en son creux, la main ouverte. Ce refus de saisir est, me semble -t-il, l’attitude première que réclame la fleur. C’est elle qui s’offre, sans cela impossible de faire pressentir son parfum ; soit elle s’échappe hors du temps pour devenir une sorte de rêve aux contours incertains et vides, soit elle prend les lourdes apparences de la seule esthétique décorative.
Il faudrait peindre une fleur avec la simplicité et le naturel d’un enfant qui joue, et qui jette une balle dans le ciel à l’âge où il est encore possible que les nuages puissent la retenir. Il faudrait pouvoir, et sans perdre le savoir retenu des années qui mènent à l’adulte, garder l’insouciance déterminée et le sérieux détendu de l’enfant qui joue. Peindre des roses… Ce que rapporte Philippe Jaccottet de l’exercice de rédaction des petits poèmes japonais semble correspondre à la difficulté de l’exercice. « Mais ce qui est simple et naturel n’est pas du tout facile (…). Il faut viser d’autant plus juste que sont peu nombreux les éléments du poème, en peser le poids sur des balances d’autant plus sensibles qu’ils sont légers. Alors seulement la cible atteinte n’est plus une cible, mais une ouverture où la flèche se sera engouffrée ; alors seulement, le coup d’éventail imperceptible aura produit une onde capable de se propager à l’infini. »
À vouloir les peindre, les roses me rendent chaque jour plus novice. À leur contact, je suis contraint au risque, poussé à tenter de nouveaux chemins d’expression, acculé de toutes parts à davantage de liberté. C’est une vraie rencontre. La rose, tout aussi inflexible que légère, engendre par nature un espace insoupçonné. La fleur en son point natif est une source. Elle semble toucher à l’être de si près qu’elle ne sait qu’engendrer de nouveaux espaces. Que la délicatesse de son apparence ne nous trompe pas, les eaux qui coulent là sont d’une grande violence. Ses volutes enivrantes cachent les traits d’une parole extrêmement précise. Elle se découvre moins contenue que les océans et pourtant ramène toujours au centre. Elle est juste heureuse d’être, comme un enfant, juste cela, être. Juste être, pour rien, pour ne servir à rien, parce que cela suffit et parce que, de même qu’un enfant perd l’enfance sitôt qu’il se pense important, elle ne serait plus une fleur si elle prétendait faire quelque chose d’utile. Je crois que cette gratuité-là est plus puissante et essentielle que l’ensemble des efforts qui transforment le monde, que ces efforts-là sont vains (et dangereux) s’ils ne sont pas pour découvrir cela. Sans cette certitude, je ne serais pas peintre…
Voici déjà quelques années, qu’à ce sujet j’écrivais : « À côté de moi, tout à côté, au milieu des broussailles qui dévorent une barrière, une unique fleur est ouverte. Elle est fine et délicate. Elle est blanche. Au cœur de cette grisaille, de cet univers de béton, de violence et de bruit, sa fragilité m’émerveille. Je la regarde et la regarde encore. La beauté qui s’échappe d’elle s’offre à ma nuit comme une lumière pénétrante. Il me semble l’entendre maintenant. N’avez-vous jamais entendu une fleur ? C’est étrange et bouleversant. Elle me dit qu’elle s’appelle « inutile » et qu’elle ne pousse pour rien sinon pour la joie d’être fleur, et que c’est pour cela qu’elle est belle. (…) À ceux qui sans elle ne peuvent respirer, elle offre comme une porte vers l’infini. Les autres (…) ne la voient pas.
Quoi de plus discret qu’une fleur qui perce l’hiver, quoi de plus vulnérable ! Et pourtant, ce matin, sa puissance m’apparaît évidente. C’est comme si, à elle seule, elle justifiait toute la ville, comme si elle rachetait toute la laideur du quartier par le seul poids de sa grâce. C’est inouï la puissance de la grâce. Elle me dit encore de tacher de lui ressembler pour la seule joie de Celui dont elle est le reflet. Le monde a froid, et seuls ceux qui acceptent de brûler pour rien peuvent le réchauffer. C’est incroyable tout ce que peut dire une fleur, vous ne trouvez pas ? Je me sens maintenant tout léger, la joie est revenue m’habiter, ainsi que le courage. En quelques instants tout a changé, tout s’est inversé. (…)
Et souviens-toi de mon nom, « inutile », je suis inutile, ça n’a l’air de rien mais ça change tout… » [1]
Aujourd’hui, et après plusieurs semaines de travail, je rends ma copie. De cette expérience quelques tableaux restent mais surtout, le sentiment d’avoir été plongé dans l’essence de la démarche artistique, quelque chose que l’art partage avec les fleurs, une présence essentielle parce qu’inutile. Je reviendrai je pense, plus que je ne l’ai fait ces dernières années, à la simplicité apparente des fleurs. J’y partirai comme l’on part en pèlerinage, en devoir de mémoire. J’y partirai surtout comme l’on va chez des amis, retrouver quelque chose d’essentiel que l’on ne trouve que là et qui dit à peu près ceci : « Et souviens-toi de mon nom, « inutile », je suis inutile, ça n’a l’air de rien mais ça change tout…«