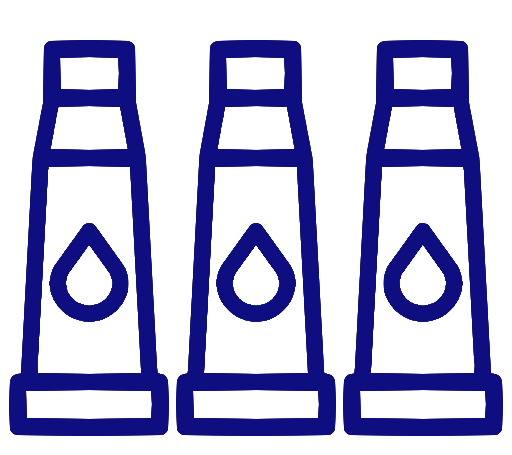Bien nommer les choses

Les temps se durcissent. L’actualité qui frappe chaque matin apporte un nouveau lot de malheurs, et ils apparaissent toujours plus irrésolubles, exponentiellement irrésolubles. Dans le silence de la campagne qui m’entoure, l’air qui embrasse chaque chose semble aujourd’hui être habité par un étrange cri. De la plus grosse branche à la plus insignifiante des brindilles, chaque herbe des champs, chaque feuille d’arbre, semble dire à sa façon qu’un autre temps est venu. Même l’oiseau qui cherche une miette en hâte ne surprend plus. Fini le temps de l’insouciance, fini le temps des projets et de l’enthousiasme, une étrange asphyxie vicie désormais l’oxygène. Rien d’officiel certes, rien de précis non plus qui puisse me faire dire « à partir de tel jour telle heure, nous avons basculé ». Rien non plus avec quoi je pourrai fonder un quelconque retrait de la clarté. Rien, pas une certitude à afficher, aucun élément de preuve, juste ce cri dans le silence et le silence de plus en plus prégnant.
Mais peut-être que je me fais des idées ? Après tout, peut-être est-ce cela vieillir ? Cette étrange mort qui étouffe ce siècle n’a peut-être rien d’objectif. J’égrainerai les nouvelles les plus factuelles, je les classerai par ordre d’arrivée depuis ces dix dernières années que cela n’arriverait pas à prouver cette urgence diffuse, ce manque de lumière, ce rhumatisme persistant. Et puis, des maux bien pires ont déjà frappé la race des hommes, ces nuages trop gris passeront vite… Peut-être…
Une racine infectée semble pourtant bien informer chaque cellule et tout le corps tremble d’une même fièvre. Elle n’empêche pas totalement de poursuivre sa route. Voilà ce qu’il parait : un nouveau principe ordonne tout à une fin qui reste voilée. Et cela m’inquiète. Et cela en inquiète beaucoup… Les pasteurs se taisent. Ils ne sont plus. Nous sommes aujourd’hui habitués à ce qu’ils se taisent, et qu’en conséquence, à leur place, tout un chacun s’exprime. Adultes, enfants, femmes et hommes, chacun à son heure tente gravement de nommer le mal, mais il n’a pas d’être. Alors, devant la complexité à définir le malaise, seule la conscience soudaine de l’infondé des propos s’affirme ; et la parole est abandonnée là, en cours de route, sans parvenir à son but. (Qu’importe ?! La fièvre n’empêche pas totalement de poursuivre la route.) Le bruit qui en résulte participe à épaissir la peur sans que rien ou presque ne soit nommé et entendu. Aucune main ne semble assez agile pour saisir le mal que l’humanité respire. C’est un ennemi volatile, une traînée de gaz qui ne s’estompe pas totalement, le manque du bien essentiel. Bientôt, la quantité deviendra la qualité et personne ne pourra plus rien nommer qui corresponde à la réalité…
S’il est vrai que jusqu’à ce jour rien encore n’a définitivement assombri le ciel, il n’en reste pas moins vrai qu’un filtre atténue la joie des jeunes gens, ils semblent moins pressés de vivre. Ils ne sourient plus… Même la joie des enfants semble préoccupée, empêchée d’être totalement. (Qu’ils soient, les enfants, eux aussi empêchés d’être est une fièvre acquise depuis longtemps, elle n’empêche pas de poursuivre sa route.) Le désir irrépressible d’un bien que l’on a voulu absent laisse place à l’éclatement même du désir puis à son extinction. Les plus anciens tentent de se souvenir. Les plus jeunes – et je les entends fréquemment parler entre eux – tentent d’imaginer « comment c’était avant »…
Le constat est terrible : Personne n’ose plus regarder ce présent-là avec sérieux.
Les traits du visage de l’homme semblent se dérober tant ce dernier est exclu de son présent. Définir la forme du visage humain aujourd’hui c’est définir l’absence de ce visage, la disparition en cours de ce visage… L’homme semble chassé du deuxième jardin, il se doit de vivre à un jet de pierre de sa vie. C’est comme si le réel était devenu trop brûlant pour lui, il doit l’approcher en se protégeant derrière un pseudonyme, par écran interposé. Le mal qui semble frapper à la porte de notre temps dévoile une impossible présence, l’incapacité d’un face à face, une irrationalité fuyante, un visage que la peur masque plus que la raison… L’impossible visage empêche l’objectivité. Ce qu’il y a de plus irréductiblement autre s’efface. L’imprévu est l’ennemi à éviter absolument. Le ciel algorithmique ne peut tolérer le risque qu’il impose. Nous sommes désormais la proie d’une subjectivité immédiate, réduits à un impossible sortir de soi (et de chez soi selon les heures). Cela interdit toute véritable connaissance. C’est une prison des plus rétrécie, une captivité des plus absolue…
Ce long préambule s’impose tant il est vrai que depuis quelques mois ce mal-être général semble frapper avec plus d’insistance à la porte de mon atelier et je sais bien que, d’une manière ou d’une autre, son influence, bien que filtrée, s’exerce sur mon travail. J’ai traversé des nuits qui cherchaient à me convaincre de l’absurde de ma situation. Je me suis demandé avec angoisse si l’heure était encore à peindre. Et si oui, à peindre quoi ? L’autre jour une dame a pris la peine de m’écrire ces quelques mots : « S’il vous plaît, donnez-nous des fleurs, des fruits, des papillons…le moral est au plus bas et vous savez faire de si belles choses ! » Je comprends la demande et elle est légitime, mais j’ai peur qu’à l’excès elle en vienne à « rétrécir » la beauté. (Elle ne se pose qu’à sa guise dans une main dont elle sait qu’elle restera ouverte.) Dois-je me réduire à une esthétique enjouée ? Face à cette demande j’avoue être impuissant et je ne peux que répondre :
« Je ne sais faire qu’une seule chose, essayer de dire l’objet dans son temps… »
À certaines heures, la colère monte et la révolte cherche à envahir le Zélote que je suis. J’entends des conseils qui voudraient que je signe des tableaux « plus engagés »(?!), qui dénoncent ceci et cela. La tentation voudrait que mon travail ne devienne qu’une pétition supplémentaire, une manif de plus… Mais que ferait du bruit que l’on rajoute au bruit ? Et je suis bien obligé d’avouer à mes prétentions révolutionnaires :
« Je ne sais faire qu’une seule chose, essayer de dire l’objet dans son temps… »
À ceux qui voudraient moins que cela comme à ceux qui voudraient davantage j’exprime mes regrets désolés et je redis : je cherche seulement la note juste, l’attitude qui fait que la vie puisse trouver son chemin dans ce siècle. Sans cet ajustement constant, mon travail n’a plus de raison d’être… « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » affirmait Albert Camus. J’ose espérer dans ce monde en dérive que les bien nommer offre un point d’ancrage suffisamment solide pour que puisse s’y accrocher un possible bonheur.