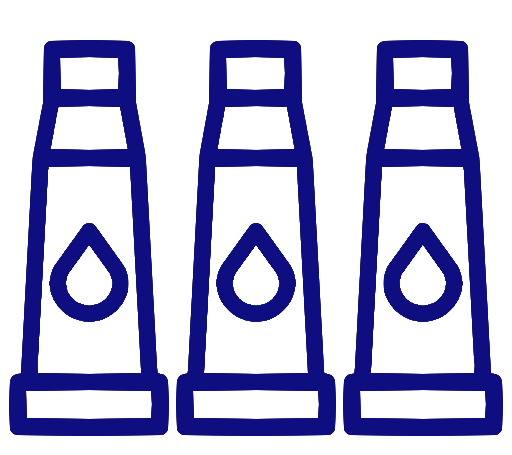Beethoven et la dérive du monde

C’est sous une chaleur caniculaire que je roule en direction de la ville où se trouve le Lycée de mon fils. C’est la fin d’après-midi et il a terminé les écrits de son bac. Il est 18 h et aucun bus ne peut le ramener dans notre petit village de campagne. Je viens de recevoir un coup de fil pour aller le chercher. Je termine tout juste mon travail. Voici des jours et des jours que, dans le bruit et la chaleur, je travaille dans cette usine. Les heures se suivent, longues et semblables, et cette monotonie rassurante et sédative cherche à se poursuivre au-delà de l’enceinte de cette manufacture, le souvenir des ces derniers jours ne se dissipe pas. Sur cette chaîne de montage, je confectionne des chaussures, bataillant avec des machines étranges qui tentent à chaque instant de me broyer les mains. En peu de temps, c’est toute ma vie qui semble s’être rétrécie aux dimensions prévisibles de ces outils mécaniques automatiques. Nous sommes une bonne centaine à vivre là au rythme de la taylorisation. Pas une seconde à perdre, je dépends du rendement de celui qui me précède et mon suivant attend le produit de mon effort. La cadence est supportable, mais elle ne tolère pas la rêverie. Certains sont ici depuis plus de 40 ans. Parfois depuis l’âge de 16 ans, ils attendent, comme face à un sablier immense, que le dernier grain de sable tombe et les libère vers une retraite autant attendue que sublimée. Cette semaine, la sonnerie de fin de journée a libéré l’un d’eux. Autour de lui, nous avons tous applaudi ses dernières secondes de travail. J’étais à son côté lors de l’évènement. L’homme, timide, vivait intensément ses derniers instants de travail. 44 ans ! Arrivant au centre ville, près du lycée, je pense encore à tout cela, à cet homme, à ces machines, à cette cadence maintenue, au carcan que cela impose à la vie et à la nécessaire sueur pour arriver à la gagner. Dans les odeurs nauséabondes des embouteillages, sous la chaleur et la fatigue, je manque de ciel, d’espace, d’eau vive. J’attendais tout à l’heure que sonne la pause, j’attends maintenant que le feu rouge passe au vert…
Noël monte dans la voiture, après un temps, je l’interroge sur l’examen. Apparement, cela s’est bien passé, il reste évasif. Visiblement, sa préoccupation est ailleurs. Il semble vivre le lycée comme je vis l’usine… Soudain, la voix se fait plus claire : « Papa, tu connais la 7ème symphonie de Beethoven? » Puis, il branche le téléphone sur l’autoradio. La musique éclate aussitôt. En un instant, c’est comme si la vie reprenait ses dimensions réelles. L’étrange emprisonnement auquel tout semblait réduit vole en éclat. Je monte le son. J’ai l’impression de respirer après une trop longue apnée. La musique du maître révèle l’intensité de ma propre existence. Tout est là, dans quelques portées, l’immensité du cosmos, la confrontation avec la puissance ordonnée des éléments, l’intensité du drame, la gravité du tragique, la raisonnable audace de l’espérance, sa lumière… La joie m’envahit, le monde n’est pas ce que l’on nous en dit ! En un instant, la musique du maître transcende tous les calculs, le coeur vibre, il trouve un aliment et un chemin. Il fait toujours aussi chaud et mes mains me font toujours aussi mal ; mais la vie est possible. Elle n’est plus conditionnée par cet étrange métrage obligé, elle retrouve son amplitude et son goût d’infini. Le monde me redevient ami. La vie était là et je ne le savais pas. Maintenant, comme la musique, elle me traverse.
Comprenons-nous bien. Je ne parle pas ici d’une fuite vers une réalité autre – en l’occurrence la musique. Il n’y a pas « le monde et ses difficultés » d’un côté et « l’art et ses suaves effluves » de l’autre. Je parle d’épouser l’existence dans toute sa densité. En rien l’expérience artistique n’annihile l’actualité de ma vie ni celle du monde qui l’entoure. Les circonstances qui la déterminent ne s’effacent pas. Tout cela est remis à sa juste place. La visée de l’artiste est si juste et profonde qu’elle ordonne à elle tout le reste. L’œuvre opère comme le sacrement de la sagesse. N’est-ce pas dans le monde une des prérogatives de l’art : offrir la possibilité d’une expérience qui mette chaque chose à sa place, redonne au temps sa durée, à la vie ses vraies dimensions. L’œuvre est un lieu où le réel s’exprime.
Tout passe. Tout passe, et cela s’accélère. Nous vivons dans un monde mouvant et plus nous nous débattons plus nous nous enfonçons. Ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui, et ce qui l’est ce jour demain ne le sera plus. Tout converge aujourd’hui à fabriquer l’homme de demain sans socle ni repère. Changeant de but (et de genre) quatre fois par heure, comme les reflets du courant passent sans cesse du sombre à l’éclat, l’homme de surface n’aura ni mémoire, ni désir, ni densité. Charles Péguy constate, « Le monde descend le fleuve, les cadavres plus vite encore. »
En touchant à quelque chose de la substance de l’existence, l’artiste ouvre au monde un point qui ne passe pas. Son intelligence tournée vers la source, il fixe à la dérive un ancrage. Immobile, seul un bouillonnement d’exigences et de sens demeure. Nous ne baignons jamais deux fois dans le même fleuve, enseigne avec profondeur l’obscur Héraclite. À l’heure où la société semble se liquéfier davantage encore, mieux vaut prendre conscience de la source que d’essayer de nommer le courant. Le fleuve demeure, et de cet immuable, il est possible de dire quelque chose. Je suis de ceux qui pensent que cette parole est des plus essentielles, qu’elle sauve davantage de personnes que la transition écologique, l’appli tous-anti-covid et la Commission Européenne réunis. La 7e symphonie de Beethoven participe de cette parole. C’est une caractéristique de l’oeuvre d’art accomplie que de résister au courant, que d’offrir au monde les calmes oasis du rayonnement de l’Être, que d’endiguer les flots qui mènent au néant.
Nous pouvons traverser la vie comme une journée en usine, sans autre but que la libération de la sonnerie finale. Jour après jour, nous pouvons traverser une vie entière de travail attendant la retraite pour que commence la vie. Pareillement, nous pouvons ici attendre le ciel dans cette même attitude, celle d’une grande parenthèse, en serrant les dents et en s’appliquant pour obtenir l’éternité en récompense. Quel ne sera pas alors notre effroi de constater que ce que j’ai tant attendu avec effort était déjà là, à portée, à chaque instant, et qu’il ne suffisait peut-être que d’une symphonie pour en goûter les premières lueurs.
La vie n’est pas aussi terrible que nous l’imaginons, mais elle est bien plus dramatique…
Tout semble contenu dans la simplicité des vers d’Anna Akhmarova :
« Je ne prononce pas de prophétie
La vie est claire comme un torrent de montagne. »
Beethoven a su en quelques oeuvres offrir de cette puissante fraîcheur. Heureux qui aujourd’hui en perçoit le bruissement.