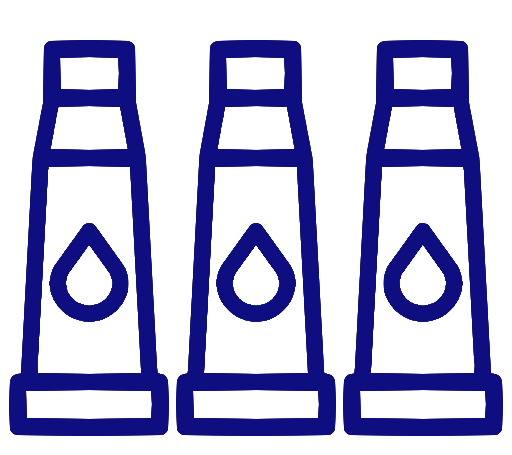La petite fille et la lumière
La petite fille et la lumière

Les concepts nous sont nécessaires pour communiquer. Ils sont même essentiels à notre intelligence. Pourtant, selon l’adage de Saint Grégoire de Nysse, l’étonnement est le milieu naturel de la connaissance. Ce n’est pas l’étonnement qui permet de construire un pont ou un avion. C’est bien par la médiation des concepts et non par celle de la stupeur que je peux comprendre un discours, un livre… Vers quelle sorte de connaissance nous ouvre donc l’étonnement ? Que nous amène-t-il à pénétrer que le concept ne nous laisse pas percevoir ? [1]
Lorsque nous parlons les uns avec les autres, le véhicule sur lequel le sens de nos conversations peut naître est le concept. Les concepts commencent à se former dès le tout jeune âge avec le langage, s’enrichissent, évoluent et font que lorsque je dis le mot pomme, tout le monde sait de quoi je parle. Il n’est pas besoin que je montre le fruit pour que chacun saisisse de quoi il s’agit; c’est heureux et plutôt pratique (surtout lorsque l’on parle d’un éléphant). Soit que je l’ai mangée, cueillie ou regardée, mon intelligence a extrait des expériences que j’ai eu de la pomme un commun, puis, d’une certaine manière l’a rangé dans un tiroir. Ce tiroir s’ouvre dès que je dis le mot pomme. Et même si pour chacun ce mot évoque des nuances plus ou moins différentes, qu’elles soient plus ou moins acides, jaunes ou rouges, nous savons tous de quoi il s’agit. Le concept est donc chose nécessaire pour communiquer mais pas seulement. Intérieurement, j’ai aussi besoin de me représenter la chose connue pour pouvoir me l’approprier. De la multitude de nos expériences concrètes a été abstraite une donnée universelle immatérielle. Cette sorte d’idée générale est donc abstraite par nature, ce « verbe mental » est en nous une sorte d’image résiduelle ou « similitude spirituelle de la chose » en laquelle « se termine la résolution de l’analyse de la proposition ». [2]
Notons qu’il y a bien ici la notion de quelque chose qui se termine, une sorte de réponse close à notre soif de connaissance. Pour cette raison le concept est également appelé « terme mental » [3] , et, sans doute, pour un esprit qui manque de curiosité et de vivacité, cela suffit. Cela suffit pour se comprendre, cela suffit pour parler… Mais l’image de la pomme, n’est pas la pomme.
Yves Bonnefoy nous met en garde « lorsqu’on parle on répète, quand on répète on fait que les choses disparaissent devant notre regard » ; et de constater « il y a dans les mots une inertie, ils ont tendance à se perdre au plus loin de leurs emplois vifs » (…) [4]
L’emploi incessant des concepts engendre une forme de nominalisme en lequel nous nous suffisons et qui empêche l’irruption d’une réelle connaissance. Nous oublions que le point de départ de la connaissance n’est pas cette image mentale mais la réalité qui vient en amont. Loin des formules creuses qui lassent autant ceux qui les entendent que ceux qui les prononcent, il y a dans la confrontation avec les choses banales l’expérience d’une présence, une forme d’amitié que l’être nous donne d’éprouver.
J’aimerais essayer de montrer cela en décrivant un souvenir vieux de plus de 10 ans et qui pourtant demeure toujours aussi vibrant dans ma mémoire.
Invités à un mariage, nous sommes tout un groupe d’amis à bavarder dehors. La messe est dite et le consentement donné. C’est la fin de journée, les ombres se font plus longues et nous attendons sans même y penser la suite des évènements. Il fait bon en ce soir de printemps. Abrité sous les arbres du parc je peux entrevoir la magnifique prairie qui leur fait suite. Le château où nous sommes invités est derrière nous et aucune habitation n’empêche la vue de s’étendre. L’heure est heureuse. Bon nombre d’enfants s’amusent autour de nous, les miens sont quelque part. Je remarque une petite fille plus solitaire. Elle ne semble pas jouer avec les autres mais avance lentement vers l’orée du bois. Elle est encore dans l’ombre mais la lumière l’attire. Ses pas l’amènent doucement devant la prairie et déjà, la lumière du soleil qui fuit éclaire son visage. Ça y est, elle voit! L’étendue verte de l’herbe comme un tapis à une reine, son visage s’illumine, ses yeux rient, sa bouche s’ouvre dans un éclat de stupeur. Personne ne semble la remarquer, je ne vois qu’elle. Les conversations autour de moi s’estompent tant le spectacle est prenant. La petite fille ne semble plus faire qu’un avec la lumière qui s’offre à elle.
C’est comme un silencieux dialogue qui dirait « je suis la lumière, je suis l’étendue devant toi et aussi, je suis l’herbe à tes pieds » . Et elle de répondre immobile, « je suis une petite fille, je suis pour la lumière, je suis pour l’étendue devant moi, pour l’herbe à mes pieds » . Une correspondance parfaite, à cet instant, dans cette lumière du soir, devant cette vaste étendue d’herbe jeune. Il me semble voir les mots que Claudel met dans la bouche de Violaine : « Ah, que ce monde est beau et que je suis heureuse! » [5] Tout semble dire à cette enfant « Je suis pour toi » et elle l’entend, parce qu’elle est une enfant, elle le comprend et elle répond également « je suis pour toi » . Bien sûr, je n’entends rien venant de la lumière, pas même de la jeune fille ; tout cela se passe dans un silence magnifique où les éléments et l’enfant paraissent suspendus l’un à l’autre, étonnés l’un de l’autre. Je suis ému aux larmes, je sais le spectacle fugitif… Soudain, et comme étant la seule réponse juste, la petite fille s’élance et se met à courir dans l’herbe ! Je la vois s’éloigner en riant, sa robe blanche va de droite et de gauche, elle saute et tombe et se relève… Je suis pour toi ! je suis pour toi ! Elle est la part manquante des éléments, ils semblent ne pouvoir s’achever qu’en elle. Sa course actualise et la lumière et l’espace, l’herbe ; eux, sont la visée de sa course. Chacun semble trouver en l’autre sa finalité. C’est elle, maintenant, la mariée. L’étonnement a rendu présent son invisible époux. Elle répond à la proposition de la lumière, à celle de l’herbe et de l’espace qui n’ont de cesse de s’ouvrir devant elle ; elle y répond totalement, sans retenue.
La lumière est-elle plus belle lorsqu’elle touche le visage d’un enfant ? L’herbe est-elle plus verte lorsqu’ils y jouent ? Et l’espace ne se ferme-t-il pas lorsqu’ils viennent à manquer ? Je reviens aux conversations d’adultes, la saveur a quitté l’endroit. Je m’ennuie, on nous invite à prendre un verre.
L’étonnement ne naît pas en face d’une idée générale et abstraite mais devant la sollicitation du réel. Il ne naît pas du concept de « pomme » , il naît devant « cette pomme » , ici, maintenant ; dans l’expérience d’un face à face qui, nous le verrons plus loin, ouvre et conduit à un autre face à face.
Notons que, spontanément, l’étonnement ne nous verse pas dans une connaissance d’ordre scientifique. Bien sûr, je ne disqualifie pas cette nécessaire approche, mais force est de constater que la stupeur n’engendre pas le positivisme. Davantage que vers un savoir quantifiable, plus profondément que l’acquisition d’une rassurante grille de lecture, « le saisissement » nous révèle une déroutante présence. Face à la beauté rencontrée là, l’enfant ne s’interroge ni sur la botanique ni sur le calcul de l’intensité de la lumière. Elle ne s’écrie pas « Oh, 3,7 hectares ! » Pas davantage « Mais c’est un mélange de Festuca rubra et de ray-grass! » Elle ne tend pas vers quelque chose qui pourrait lui donner une explication, une repère; et pourtant, il n’est rien qui ne soit étonnant dans son attitude.
Elle est totalement rationnelle. L’étonnement insuffle cet élan qui nous fait sortir de nous-mêmes pour aller au-devant des choses en restant désarmés, sans a priori sur elles mais avec une sorte d’élargissement de l’intelligence qui l’ouvre à la possibilité d’une rencontre. Il me donne la force de prendre le risque d’une réponse qu’il ne m’est pas permis de donner sans un réel engagement, une réponse qui est « je » , qui est « moi-même tout entier et sans retour » . D’une certaine manière, (comme la petite fille dans ce décor du soir), l’étonnement nous introduit à l’intérieur de la manifestation des choses, il nous donne de les épouser pour que nous en ayons une expérience intime, sûrement descriptible mais pourtant, tellement profonde et personnelle qu’elle devient le véhicule d’une vie quasiment incommunicable. L’art est, à mon sens, le langage qui s’essaie à cette mise en acte. Cela se passe sous un mode suggestif, le rapport à l’objet concret nous communique un goût qui nous ouvre à une promesse de davantage. Les sollicitations qu’exercent sur nous la simple présence des choses nous ouvrent à un désir profond et naturel. Comme la faim nous fait deviner le pain, comme la soif nous fait désirer l’eau, l’étonnement est le milieu qui nous fait désirer une présence, et il le fait en nous donnant déjà d’y goûter. Le véritable terme de la connaissance est ce face à face ultime, une ouverture vers un « non-terme » car de nature infinie, vers un « non-connu » car toujours à découvrir. La connaissance est cette pénétration, ce franchissement du gouffre de chaque chose vers la conscience de cet incessant dépassement que l’objet est en lui-même.
Je le redis, cela est déroutant. C’est même épuisant, tellement inconfortable qu’à certaines heures l’on aimerait bien pouvoir fermer les yeux et s’endormir, confortablement installé sur le terme rassurant d’un immobile concept. Mais le chemin est autre. C’est comme si l’objet connu, après avoir concrètement exercé sur nous une attraction suggestive, s’effaçait. « En réalité, l’orientation du devenir recèle aussi une orientation en sens contraire » [6] . Ce que j’appelle le gouffre de chaque chose est cet instant où nous demeurons suspendus au seul désir que nous a laissé un objet disparu. C’est un incessant point de basculement. Il a suscité en nous un attrait suffisamment fort pour que, d’une certaine manière, nous le suivions, puis il prend un autre chemin qui semble contredire le premier. Est-ce le sens de ce paradoxal Upanishad que nous livre la sagesse de l’Inde ? « Dans de noires ténèbres plongent ceux qui se prosternent devant le non-être ; vers des ténèbres plus noires (encore), pour ainsi dire, vont ceux qui trouvent leur joie dans l’être » . Le gouffre est une sorte de morsure en laquelle il est possible de prendre conscience que l’objet n’est pas le terme de lui-même, « qu’il demeure à tout moment lié au non-être, intérieurement sans sécurité et à tout instant sauvé du néant grâce à la seule main de Dieu. » [7] Après nous avoir éveillé il désigne sa source.
C’est à mon sens sur l’échelle de cette respiration que l’art doit se tenir. La musique, par exemple, peut exprimer un sentiment en l’épousant dans la durée. Le cinéma, selon les mots de A. Tarkovsky, « sculpte le temps » pour dire la vie. La peinture me semble être d’un seul mot, d’un seul choc, d’une seule note ; et l’amplitude de cette apparition / effacement lui est inaccessible dans sa totalité si elle ne plonge dans l’instant pour la retrouver. Qui trop embrasse mal étreint. Aussi, il me semble que dans ce mouvement qui inspire et expire, le tableau doit choisir une place, ne pas chercher à raconter une histoire, pas même à créer une ambiance, mais seulement accepter de tomber vers cette présence dont la porte d’entrée semble être un gouffre. Si la chose te brûle de son rayonnement, alors peint la rayonnante. Si elle t’apparaît aujourd’hui banale, peint cette platitude. Si la puissance de sa manifestation semble se dérober vers sa source, tache de signifier cela.
La cohérence tient de la visée d’un seul but. Ce qui garantit l’unité d’une vie de travail est la direction prise, non l’uniformité esthétique. Je fais le choix du face à face avec l’objet, et j’essaie de l’épurer toujours plus de tout ce qui ne conduit pas directement à sa source, tout ce qui chercherait à le détourner vers une histoire, une idée, une revendication. Je voudrai le dire nu, que lui se dise, qu’il s’affirme et qu’il s’efface pour conduire chacun en ce point mystérieux où il participe à plus grand que lui.
« Les concepts créent les idoles (de Dieu), le saisissement seul pressent quelque chose, ou plutôt quelqu’un » . [8] Sans mettre en réelle opposition l’étonnement et le concept, St Grégoire de Nysse, nous indique clairement deux chemins possibles, et ils ne se rejoignent pas. L’un mène à une connaissance qui est une forme de pénétration, d’ouverture à l’intérieur de l’objet, l’autre à une sorte de vénération de la représentation que j’ai de la chose, une espèce d’illusion focale qui enferme l’objet et nous le rend fascinant plus que de raison. La conséquence à long terme est une espèce de prétention qui privilégie l’idée plus que le réel, le processus mental plus que l’objet. Le sens conaturel à l’objet nous tourne vers l’expérience d’une présence, la non-fréquentation de l’objet nous prive de cette reconnaissance.
Dans les années 1960, suite au courant minimaliste (qui englobe l’environnement comme partie prenante de l’œuvre) et au très intelligent ready-made mis en œuvre par le français Marcel Duchamp, va naître l’art conceptuel, courant important de l’art contemporain. Sans vouloir entrer dans d’inutiles et interminables polémiques, je crois qu’il est possible d’affirmer de façon assez objective que l’art conceptuel est par nature en contradiction avec un art qui trouverait sa source dans l’étonnement. Si une tradition prend pour point de départ le point de rencontre avec le réel et comme développement l’énergie naturelle qui en découle, l’autre affirme, selon Robert Atkins, « la réduction de l’art à des idées pures, où n’intervient plus aucun métier artistique » . Les deux approches mériteraient une interprétation moins simpliste et davantage nuancée qui, sûrement, mettrait en lumière que les frontières demeurent poreuses. Cependant, il est clair qu’ici, pour l’artiste, deux chemins se séparent. Un choix s’impose. Deux points de départ distincts, deux principes de développements différents conduisent généralement à deux finalités différentes.
J’aimerai conclure avec la parole d’Yves Bonnefoy qui, constatant la démission des mots, affirme que « la poésie a surtout cette fonction négative de recréer à chaque instant le langage comme réalisme véritable », qu’elle a « pour fonction de faire réapparaître la réalité » [9] . Non pas de la décrire, mais de l’ouvrir en ce point où elle donne envie d’être découverte. L’art a pour vocation de faire renaître le monde en l’état de question ; non pour y trouver un terme mais pour en expérimenter cet espace qui suscite en nous le désir de courir. Au final, l’art n’est peut-être rien d’autre qu’un champ d’herbe verte dans la lumière d’un soir…
| ↑1 | St Grégoire de Nysse 335/395. » Les concepts créent les idoles (de Dieu), le saisissement seul pressent quelque chose, ou plutôt quelqu’un. » Patrologie |
|---|---|
| ↑2 | Jacques Maritain, Élément de philosophie – l’ordre des concepts. Petite logique |
| ↑3 | Jacques Maritain, Élément de philosophie – l’ordre des concepts. Petite logique |
| ↑4 | Yves Bonnefoy France Culture 1960 https://www.youtube.com/watch?v=Hiu2K19msU0 |
| ↑5 | Paul Claudel, L’Annonce faite à Marie |
| ↑6, ↑7 | Hans Urs von Batlthasar, La Théologique 1 P262 ed Lessius |
| ↑8 | St Grégoire de Nysse 335/395. Les concepts créent les idoles (de Dieu), le saisissement seul pressent quelque chose, ou plutôt quelqu’un. Patrologie |
| ↑9 | Yves Bonnefoy, France Culture 1960 https://www.youtube.com/watch?v=Hiu2K19msU0 |